L’envie nous a pris de passer la fermeture avec les agents d’une fédération de pêche. Les suivre une journée dans leur métier, découvrir le territoire tel qu’ils le connaissent, discuter de la réalité du terrain, rencontrer les pêcheurs et en prendre plein les yeux. Cette fédé, c’est celle de Savoie, où Fabrice et Jules vont arpenter l’Isère dans son cours moyen, et quelques affluents, pour une journée de contrôle.
C’est un samedi, mais le rendez-vous est fixé à 6h30. Car si on considère le lever de soleil à Chambéry, la journée de pêche commence légalement à 7h15. Ce matin, ils travaillent avec deux hydroguides d’EDF. Ces personnes sont chargées de faire de la prévention et de la sensibilisation. Notamment auprès des pêcheurs, concernés par le risque de montée des eaux brutales et les interdictions d’accès au lit mineur, dû à l’activité hydroélectrique.

Les pêcheurs sont peu nombreux au petit matin, ce qui est presque rare pour un samedi de fermeture. Ici, en Savoie, la fermeture se fait trois semaines plus tard que dans la plupart des autres départements. C’est une spécificité des départements dont une partie de leur territoire est situé en haute montagne, comme pour compenser les débuts de saison encore froids, et les rivières printanières gonflées par la fonte des neiges (quand les saisons avaient encore un sens…). Pour dire que l’arrière-saison savoyarde est convoitée par les pêcheurs voisins. Ceux-ci n’ont pas besoin de carte supplémentaire pour aller sur l’Isère, qui, faisant partie du Domaine Public Fluvial, est accessible de droit à tout adhérent d’une association de pêche (AAPPMA).
D’Albertville à Moutier, nous faisons des sauts de puces, de ponts en parkings, cherchant les pêcheurs, ou d’abord leur voiture. Nous en croisons, tous en règles, certains contents de la présence de la fédération au bord de l’eau. Leurre, nymphe, toc, toc nymphe, vairon, tout est représenté. Les plus jeunes sont au leurre, les moucheurs ont les équipements les plus sophistiqués, et les plus anciens pêchent au vairon. Nous croisons aussi les riverains, qui suivent du regard le 4×4 remonter les pistes au ralenti, des chasseurs, deux biches et un faon.




Corsetée entre deux digues, l’Isère demeure une belle rivière, avec une population de truite stable ces dernières années et avec des taux de croissance qui participent à sa réputation. Malheureusement, deux phénomènes en œuvre depuis déjà longtemps sont très limitants pour le milieu.
- En premier, c’est l’homogénéisation des profils d’écoulement de la rivières (le méandrage et l’alternance radiers/fosses notamment). L’Isère tend à devenir davantage rectiligne et fixe dans le temps. Le berges et bancs se réhaussent également, par accumulation anormale de fines particules de schiste, fortement présentes, dont le transite est ralenti. Elle ne parvient plus à remodeler ses bancs et tracer de nouvelles trajectoires, choses essentielles à la pérennité d’un écosystème fluvial.
- En second, ce sont des perturbations régulières et/ou généralisées de l’habitat. Il y a le colmatage engendré par l’excédent de poudre de schiste, qui menace les zones de frai et la microfaune qui vit dans les galets de la rivière. Puis, surtout, il y a les variations brutales des niveaux d’eau.
Les causes de ces phénomènes menaçants sont multiples et se cumulent, mais toutes sont induites par l‘activité humaine. Fabrice explique que l’endiguement et l’activité hydroélectrique sont les principales causes de dégradation.
- L’endiguement, bien que large, contraint la trajectoire du cours d’eau. Il empêche la rivière de changer, de divaguer et de grignoter naturellement des berges ou des bancs pour se régénérer et se diversifier.
- A cela s’ajoute l’activité hydroélectrique, qui a des impacts dû au contrôle de l’hydrologie. Premièrement, elle « démodule » le régime naturel de crue d’un cours d’eau, en captant ses crues pour les turbiner. L’absence de crue en rivière représente une menace, les perturbations régulières et de moyenne intensité sont bénéfiques. Ici, les particules de schiste qui s’amoncellent dans les zones de calme ou sur les bancs de galets sont moins bien évacuées. Secondement, cette activité entraine des lâchers d’eau puis des baisses de niveau brutales, du fait des besoins techniques pour la production d’électricité, qui peuvent piéger des poissons sur les berges et exonder des nids.
Avec l’endiguement et la raréfaction des crues, L’Isère se fige, s’accélère et parfois aussi s’enfonce. En ajoutant à cela le colmatage et les variations brusques du niveau, ces altération physiques forment comme un plafond au développement des populations de poissons (et d’autres êtres vivants probablement).


Fabrice est responsable développement de la police de la pêche et des atteintes aux milieux aquatiques au sein de la fédération de Savoie depuis 2008. Les missions de Fabrice sont bien plus étendues que la garderie. Cette année, il a consacré du temps à faire évoluer la réglementation de la pêche, à suivre les procédures de dédommagements à la suite de procès-verbaux, en collaboration avec les AAPPMA et les institutions publiques, et à assurer le suivi des sècheresses et des atteintes aux milieux.
Dans cette fédé, ils n’ont pas de garde à temps plein, en revanche, les salariés sont assermentés et peuvent ainsi tous réaliser quelques opérations de contrôle. Ce jour-là, Jules, en alternance dans un BTS Gestion et Protection de la Nature réalisait ainsi sa première journée de contrôle.


Puis, il y a les gardes bénévoles des AAPPMA, bien entendu. Nous avons d’ailleurs croisé Jean-Michel personnage chaleureux, retraité de la gendarmerie, qui voulait constater avec Fabrice la mortalité dans un ruisseau à la suite de l’incendie d’une concession automobile et l’intervention des pompiers. Nous arpentons le cours d’eau, quelques photos des victimes, un message à l’agent de l’OFB, et un formulaire de signalement sera dressé lundi ; la journée a été bien chargée.
La saison de pêche en première catégorie se clôture, mais pour la fédé le travail ne s’arrête pas là. A cette période, ils sont en pleine saison de terrain ; des pêches d’inventaire en routine, et des pêches de sauvetage, qu’ils réalisent avant des travaux en rivière par exemple. Nous repartons avec la conviction d’avoir rencontré des personnes investies pour leur territoire, avec une connaissance fine du terrain, et un bagage scientifique solide et utilisé à bon escient.
Article écrit en 2023, par Robinson Nedelec
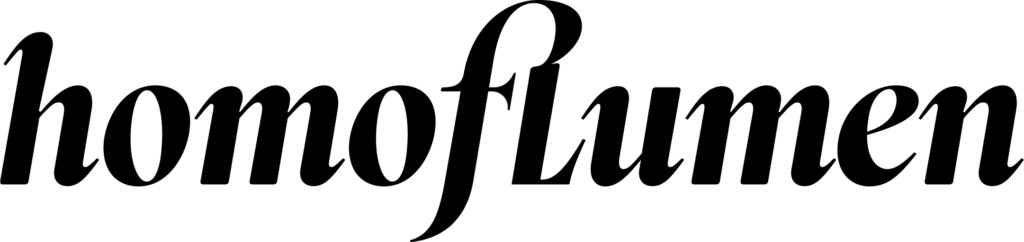

Laisser un commentaire